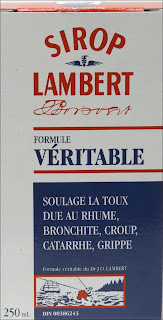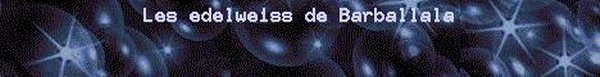Arrivé dans la capitale en 1926, l'architecte d'origine suisse Robert Blatter a contribué à la diffusion du goût nouveau à Québec.
Construite en 1934 sur le chemin Saint-Louis près de l'avenue Maguire, à Sillery, la maison du docteur Bourdon était «révolutionnaire», commente l'architecte de Québec George Leahy, qui a connu Robert Blatter, car il était un ami de son grand-père. Avec ses baies semi-circulaires, ses fenêtres en ruban, son porche et son balcon, son toit plat et ses murs de brique blancs, elle est l'illustration du style international.

«Robert Blatter n'a pas d'équivalent au Canada, soutient Leahy. Il arrivait de l'extérieur avec un oeil nouveau, une architecture nouvelle.»
Comme Le Corbusier, Robert Blatter est né en Suisse à la fin du XIXe siècle (1899). Les deux hommes ont participé activement à l'Exposition des arts décoratifs de Paris, en 1925, un événement qui a constitué un «moment magique dans la création et la diffusion du goût nouveau (...) et qui a marqué le véritable début de l'art moderne», selon l'historien Michel Lessard.
Entre 1922 et 1926, Blatter travaillait à l'atelier de Maxime Roisin, à Paris. Quand la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré a brûlé, les autorités ont invité Roisin à Québec pour la reconstruire. «Il a emmené Blatter avec lui», raconte George Leahy. Arrivé ici en 1926, il a épousé une Québécoise et a fait carrière dans la capitale, où il est mort en 1998.
Des paris sur le Colisée
C'est aussi Robert Blatter qui a dessiné les plans du Colisée de Québec, sur la base d'un brevet allemand, précise George Leahy. «Les gens prenaient des gageures sur le moment où il s'effondrerait, raconte-t-il. Mais Blatter avait fait le pari de le construire, même si ça n'avait jamais été réalisé de cette façon au Canada.»
Selon l'historien de l'architecture Luc Noppen, Blatter a conçu une dizaine de maisons de style international à Québec. Mais Paul Bourassa, du Musée national des beaux-arts du Québec, pense qu'il en a probablement créé davantage, puisqu'il n'a été reconnu comme architecte ici qu'en 1950. «Il a longtemps été dessinateur pour d'autres architectes», mentionne-t-il.
En 1929, il a accompli «un projet exceptionnel»: la maison Bélanger, qui a été détruite en 1963, pour faire place au siège social de la compagnie d'assurances La Laurentienne-Vie. «Une gaffe», résume Paul Bourassa, qu'il explique par le fait que ce type d'architecture était associé à une époque trop récente. «Elle n'était pas considérée comme une maison de notre patrimoine», dit-il.
Au 1589-1591, chemin Saint-Louis, à Sillery, la maison Kerhulu est l'une des rares résidences de Blatter qui n'ait pas été démolie ou défigurée. D'une architecture révolutionnaire pour le Québec d'alors, elle a été construite en 1945 à partir d'un dessin exécuté six ans plus tôt.
Robert Blatter avait donné à la famille Leahy son «fonds» constitué de meubles, de quelque 250 dessins et de photos des résidences qu'il avait conçues. En 1994, ils ont été déposés au Musée national des beaux-arts du Québec. Le Musée de la civilisation a quant à lui acquis une partie de l'ameublement de la maison Bélanger.
ne carrière propulsée grâce à la maison Bélanger Le coup d'envoi de la carrière de Robert Blatter a été donné en 1929, grâce au mandat de la maison Bélanger, qui lui a valu le titre d'architecte-ensemblier. Des tapis aux poignées de porte, des meubles aux lampes, de l'humidificateur au paravent, Blatter a tout conçu dans cette résidence.
À l'instar du Corbusier, Robert Blatter savait dessiner des maisons et des meubles. En 1927, il reçoit une commande de l'arpenteur de la province de Québec, Henri Bélanger, qui souhaitait encourager un jeune architecte. «Malgré la crise de 1929, il n'a pas annulé sa commande à Blatter», mentionne l'architecte de Québec George Leahy.
Dans son livre Un rêve Art déco, Danielle Rompré raconte que le coût de construction de cette maison avait été évalué à 35 000 $, soit «deux fois le prix moyen d'une résidence bourgeoise de l'époque». Sise au 131, de Claire-Fontaine, la maison Bélanger était l'une des «plus cossues de Québec». Elle a été détruite en 1963, lors du réaménagement de la colline parlementaire.
Transitions
L'auteure parle d'une «architecture de compromis» et d'un exemple de «transitions vers l'architecture de style international». «Révolutionnaire par ses formes géométriques et sa composition découpée en volumes», elle révèle aussi une influence Art déco dans «l'alliance de la pierre, de la brique et du fer forgé», ainsi que dans «l'attention accordée au portail et au hall».
Avec cette maison, Robert Blatter a misé sur un concept nouveau «où confort, luxe et dépouillement vont de pair». Il a innové en destinant le sous-sol à des fins de loisirs, alors qu'autrefois, il était surtout réservé aux domestiques. Et il nous a familiarisés avec les meubles intégrés, les matériaux faciles d'entretien, l'éclairage et la luminosité, ainsi qu'avec l'importance d'une cuisine fonctionnelle.

 J'avais pris mon appareil photo, sauf que pour changer; l'horizon était bouché du côté des Alpes.
J'avais pris mon appareil photo, sauf que pour changer; l'horizon était bouché du côté des Alpes.